Savoir Devenir à l’ère du développement numérique durable
La chaire unesco
Savoir Devenir à l’ère du développement numérique durable : maîtriser les cultures de l’Information
La Chaire Savoir Devenir est issue de l’accord de coopération entre l’UNESCO et l’université Sorbonne Nouvelle. Elle a pour objet l’étude de l’Education aux médias et à l’information, la citoyenneté numérique, les pédagogies innovantes et le dialogue des cultures. Elle s’inscrit dans les réseaux UNITWIN MILID (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue) et ORBICOM (Sciences de l’information et de la communication).
Elle est trans-disciplinaire, dans le champ de la jeunesse, de la formation et des usages sociaux et pédagogiques du numérique et des médias (du livre analogique aux dispositifs multimédia et aux métavers numérique). Elle y contribue en relayant les recherches, projets et formations de la Sorbonne Nouvelle et de ses partenaires, avec une volonté de rayonnement vers la société civile pour la professionnalisation des acteurs de l’éducation et de la médiation.
En partenariat avec l’association Savoir*Devenir et plusieurs réseaux internationaux (chercheurs, praticiens, …), elle développe ses activités par la production de ressources, l’organisation de rencontres et la publication de rapports de recherche ou des préconisations de politiques publiques sur l’éducation aux médias et à l’information, les usages numériques des jeunes, les nouvelles littératies et l’innovation pédagogique à travers le monde.
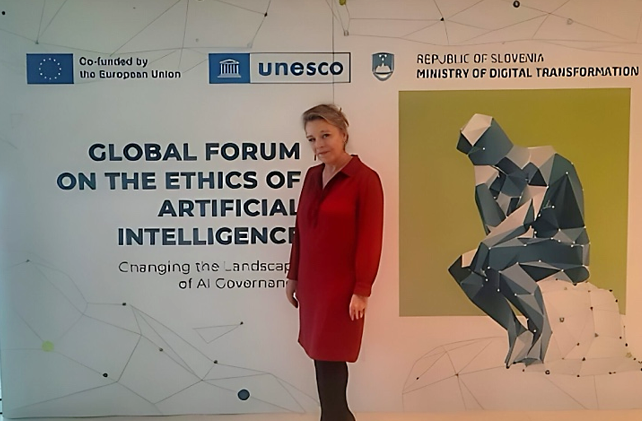
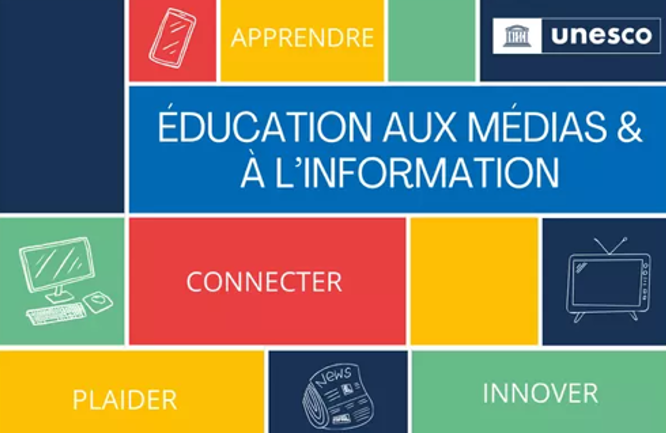
Mandat de la chaire
Savoir Devenir est un pilier de l’éducation, rajouté aux quatre piliers antérieurs : Savoir être, Savoir faire, Savoir apprendre et Savoir vivre ensemble (rapport Delors, UNESCO, 1996). Il intègre la spécificité du numérique pour rendre compte de la capacité de la personne à se projeter dans l’avenir, avec ses envies, ses besoins et ses connaissances. Cette capacité est facilitée par l’augmentation numérique, qui permet d’activer un répertoire de e-stratégies, toutes liées à des réalités cognitives permettant de surveiller l’environnement grâce aux médias et de résoudre des problèmes : le jeu (résolution de problèmes), la simulation (modélisation dynamique), l’agrégation de contenus (mise à jour de soi), l’échantillonnage (pour éditorialiser et remixer des contenus), l’interaction multi-tâches avec les outils numériques, la navigation trans- et cross- media (contrôle du savoir), le réseautage (pour la collaboration et l’intelligence distribuée) et la coordination pair-à-pair (pour la création de communautés et la co-construction de connaissances – adapté de Jenkins, 2006). D’autres e-stratégies sont en émergence, dont il faut faire la veille…
Savoir Devenir propose une inversion des processus et méthodes d’éducation pré-numériques, pour augmenter les “capabilités” (Amyarta Sen, 1985 ; Nussbaum, 2011), faire face aux mutations numériques et développer une éthique et une esthétique de vie. Ces objectifs peuvent être atteints sans passer par les programmes des disciplines mais en sont complémentaires. Les activités d’aide, de tutorat, de mentorat et d’étayage font partie du Savoir devenir car l’apprentissage ne se passe pas seul mais nécessite des médiations (humaine, pédagogique, technique) et des communautés participantes.
Savoir devenir s’appuie sur les dernières connaissances sur le cerveau et la socio-cognition ainsi que sur les cultures de l’information pour ce qui est des compétences en Education aux Médias et à l’Information (EMI) augmentées par les compétences en littératie numérique (DIGCOMP).
Objectifs
- Organiser la recherche et la formation autour du Savoir Devenir (l’art de savoir se projeter ou « forwardance »)
Les individus, de tous âges, doivent être plus conscients des affordances du numérique pour se projeter tout au long de la vie. Pour ce faire, les humanités numériques, fondées sur l’information et la communication, doivent évoluer et entrer en dialogue constructif et créatif avec les STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
- Définir la translittératie
Au sein du Savoir Devenir, en lien à l’Education aux Médias et à l’Information (EMI), la translittératie est la théorie qui permet d’articuler l’agencement multi-médias et trans-médias (pour lire, écrire et compter avec les outils numériques) ET la maîtrise multi-domaines (pour être capable de coder, chercher, évaluer, tester, valider, modifier l’information) selon des contextes d’usage pertinents, —y inclus dans le cadre de la fiction, du jeu et des échanges inter-personnels sur les réseaux sociaux.
- Inscrire la translittératie dans les enjeux info-culturels
La translittératie vise la maîtrise des cultures de l’information, à partir de “documents” (info-doc), de “données” (info-data) et d’ “actualités” (info-médias). Avec le numérique, elles acquièrent une plasticité radicalement originale, propre aux langages artificiels fondés sur l’informatique et l’Intelligence Artificielle. Ceci bouleverse les modes de représentation, de transmission et de transferts des savoirs et entraîne de nouveaux modes d’organisation des connaissances et des apprentissages.
- Lutter contre les désordres de l’information et pour l’intégrité de l’information
Les cultures de l’information sont en proie à des désordres amplifiés par les médias numériques (désinformation, discours de haine, radicalisation…). L’EMI peut former les individus à les repérer et à se doter de compétences critiques, créatives et civiques pour promouvoir l’intégrité de l’information dans leurs usages et pratiques.
- Produire des documents-cadres et des référentiels de compétences
La recherche et la formation peuvent conduire à la production de documents-cadres pour faciliter la mise en œuvre de politiques publiques en Education aux Médias et à l’Information afin d’opérer le passage à l’échelle des compétences du XXIe siècle.
- Fédérer les divers acteurs de l’Education aux Médias et à l’Information et des littératies numériques
Les cultures de l’information et les nouvelles littératies attenantes impliquent des collaborations multi-acteurs inédites, notamment celles entre les éducateurs (enseignants du secondaire et du supérieur, animateurs jeunesse…), les bibliothécaires (professeurs-documentalistes, archivistes, conservateurs…), les journalistes (reporters, fact-checkeurs, debunkers…) et les développeurs (designers, data spécialistes…).
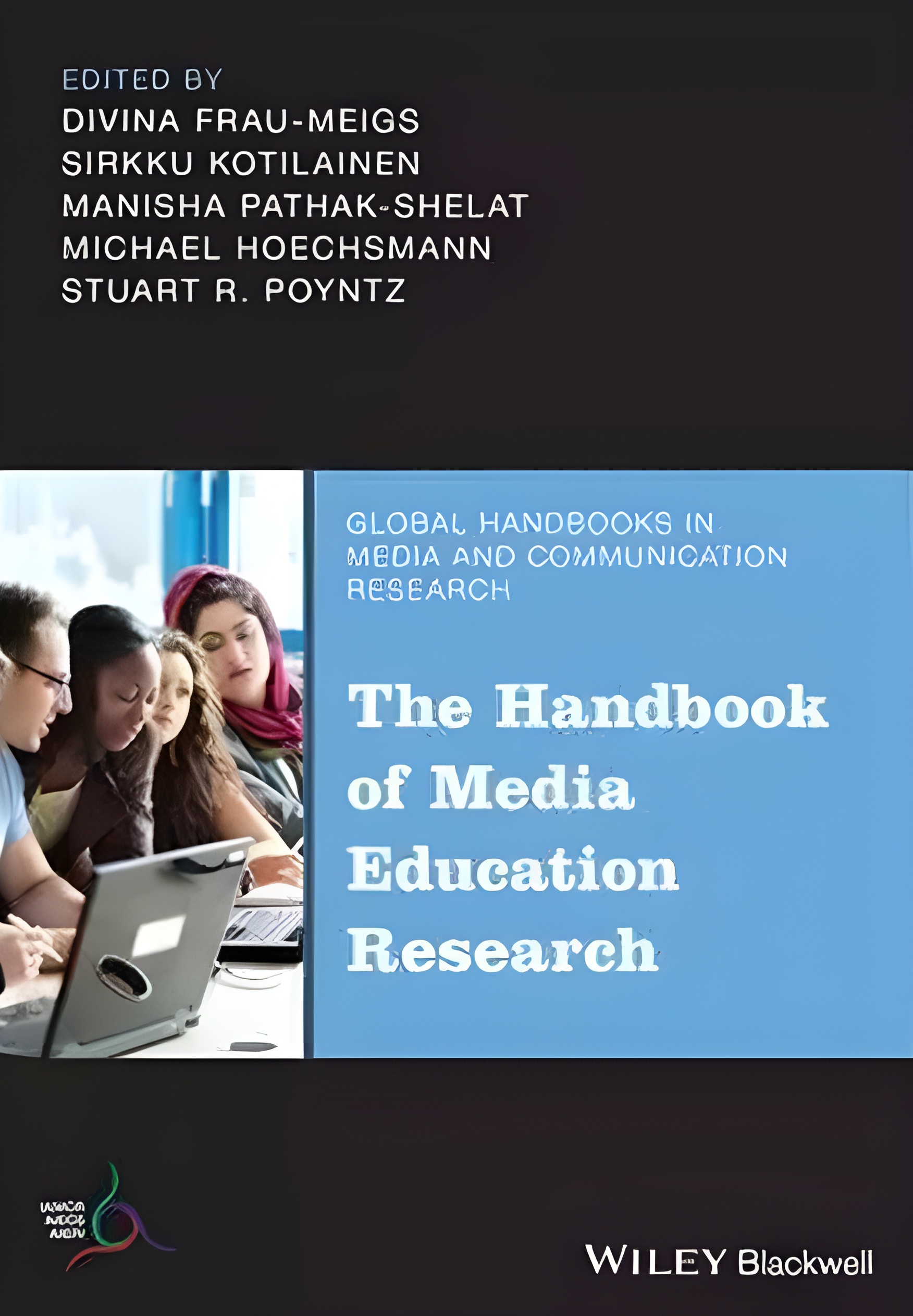
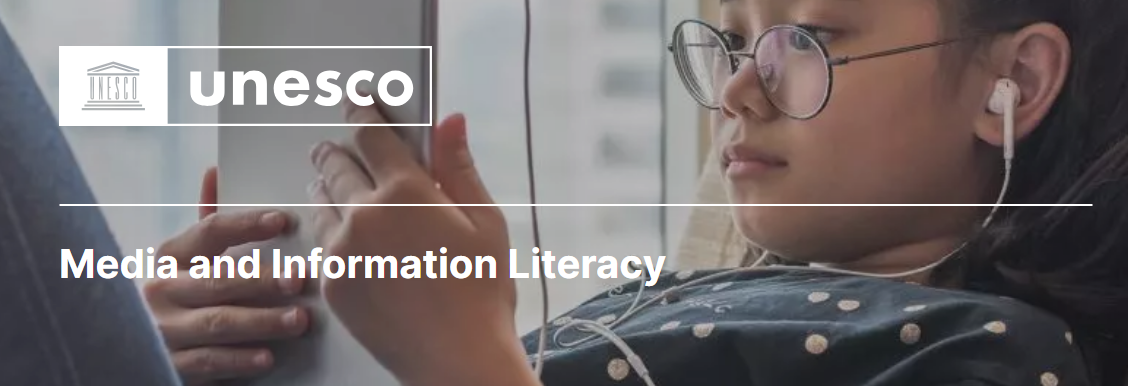
Missions
1. Renforcer les capacités par les retombées en savoirs médians en articulant usages et apprentissages
Les retombées en “savoirs médians”, définis comme la vulgarisation de haute qualité des résultats de la recherche en direction des communautés d’apprentissage et de formation, se font autour du couple “usages/apprentissages”.
Elles mettent la notion d’information au centre de différentes contraintes systémiques, pour certaines typiques de la situation française, pour d’autres partagées avec d’autres systèmes scolaires, scientifiques et économiques.
Elles recoupent les différents paradigmes d’apprentissage en présence : la transmission (savoirs constitués à reconstruire dans des institutions), la co-construction des connaissances (par le développement de compétences et d’instruments partagés de médiation) et la participation (construire des savoirs dans des communautés).
2. Contribuer au développement numérique durable
L’employabilité et la citoyenneté, tout au long de la vie, sont moteurs dans l’engagement des apprenants dans les cultures de l’information.
Les cultures de l’information sont perçues comme une étape de transition indispensable pour comprendre le développement numérique qui se met en place et en valoriser les apports pour les Sociétés du savoir (Knowledge Societies) préconisées par l’UNESCO, au-delà du paradigme dominant actuel de “Société de l’Information” (Information Society)
Le développement numérique durable n’est pas dissocié du développement humain et relève de deux urgences d’adaptation au XXIe siècle : l’urgence numérique et l’urgence climatique
3. S’inscrire dans les choix d’action prioritaires établis par l’UNESCO
L’élaboration de projets scientifiques qui articulent le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée
L’articulation recherche/ formation
L’appel aux technologies de la communication pour la formation comme pour la recherche (formation à distance, E-formation, E-learning)
L’inscription des activités dans une perspective de développement Nord/Sud et Nord/Sud/Sud
Le lien aux travaux entrepris par l’UNESCO dans le même domaine et la capitalisation sur les réseaux déjà existants (ORBICOM, MILID, GAPMIL ) et par l’Alliance des civilisations (UNAoC)
